11/11/2007
Education : disparités internationales
Extrait de la dernière livraison du Cahier pédagogique, concernant l'nvestissement des Etats dans l'éducation :
"Aucun pays réellement désireux d'atteindre les objectifs de l'Éducation pour tous ne devrait voir son action entravée par le manque de ressources". C'est ce que la Communauté internationale a promis en 2000 lors du Forum mondial sur l'éducation. Sept ans plus tard, le Recueil de données mondiales sur l'éducation de l'Unesco montre que l'effort éducatif se heurte souvent sur le manque de ressources.
Le Recueil met en évidence les énormes inégalités dans l'investissement éducatif. Ainsi alors que les pays développés consacrent plus de 5% de leur Produit intérieur brut à l'éducation, les pays d'Asie centrale et orientale dépensent moins de 3%. " Les gouvernements consacrant beaucoup d'argent à l'éducation y affectent huit à vingt fois plus d'argent, en termes relatifs, que les pays qui investissent le moins dans ce secteur.
Guinée Equatoriale : 0,6 % des dépenses publiques
Onze pays affichent ainsi des dépenses publiques en éducation qui ne dépassent pas 2 % du PIB. Il s'agit, pour les États arabes, des Émirats arabes unis (1,3 %) et du Qatar (1,6 %), pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, de l'Indonésie (0,9 %) et du Cambodge (1,9 %), de la République dominicaine (1,8 %) et des Bermudes (1,9 %) pour les Caraïbes et enfin, de la Guinée équatoriale (0,6 %), du Cameroun (1,8 %), de la Zambie (2,0 %), de la Gambie (2,0 %) et de la Guinée (2,0 %) pour l'Afrique subsaharienne" (celle-ci dépense en moyenne 4,5%).
A ces inégalités relatives s'ajoutent les écarts absolus. Qui sait par exemple que le budget de l'éducation français est supérieur aux dépenses d'éducation de tous les pays d'Afrique subsaharienne ? " C'est au Congo, en Guyane et à Sainte-Lucie que la situation est la plus dramatique. En termes réels, les dépenses d'éducation ont en effet diminué d'un tiers par rapport à 1999".
Erythrée : la moitié des enfants non scolarisés
Enfin le rapport montre les inégalités internes. Par exemple en Erythrée la moitié des enfants ne sont pas scolarisés et ne bénéficient pas de ces dépenses. En Inde la majorité des enfants a accès à l'enseignement primaire peu coûteux mais est exclue des niveaux supérieurs qui consomment un fort pourcentage des ressources."
Rapport Unesco
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_FR.pdf
00:15 Publié dans Deskadurezh/Education, Etrebroadel/International, Politikerezh/Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éducation, international
08/11/2007
Politis : commerce équitable... et bio ?
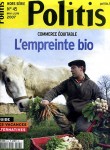 Un numéro spécial de l'hebdomadaire Politis a été publié avant l'été sur le commerce équitable et le bio. Depuis quelques années le comemrce équitable va de l'avant. On trouve maintenant de la nourriture, des vêtements et des produits "équitables" de toutes sortes dans les supermarchés. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Comment les produits équitables sont-ils produits ? Pourquoi y-a-t-il de la nourriture équitable qui n'est pas bio ? Quelle différence y-a-t-il pour les agriculteurs des pays "pauvres" ? Et pourquoi ne pas développer ici aussi, en Europe, un commerce équitable ?
Un numéro spécial de l'hebdomadaire Politis a été publié avant l'été sur le commerce équitable et le bio. Depuis quelques années le comemrce équitable va de l'avant. On trouve maintenant de la nourriture, des vêtements et des produits "équitables" de toutes sortes dans les supermarchés. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Comment les produits équitables sont-ils produits ? Pourquoi y-a-t-il de la nourriture équitable qui n'est pas bio ? Quelle différence y-a-t-il pour les agriculteurs des pays "pauvres" ? Et pourquoi ne pas développer ici aussi, en Europe, un commerce équitable ?
Voici quelques-un des thèmes de ce numéro spécial, très intéressant. Car il y a du débat, une vraie polémique. Le bio est une façon précise de cultiver des légumes, des fruits, d'élever des animaux, de les soigner aussi, sans mettre de produits chimiques. Les lois sont précises pour le bio. Et ce label est donné par des sociétés certifiées par l'Etat indépendantes des producteurs ou des commerçants bio (comme Ecocert), ce qui n'est pas vrai pour le commerce équitable dont les produits sont contrôlés par des gens issus du commerce équitable.
Equitable ne signifie pas bio
Une autre différence : dans l'alimentation équitable, on peut trouver des produits chimiques, leur utilisation n'est pas interdite, comme l'explique Christian Jacquiau* : dans des ananas "équitables" cultivés au Costa-Rica, des traces de pesticides ont été retrouvées en 2006, et même des traces de cadmium (un métal lourd) !
C'est une bonne idée de payer les agriculteurs à un prix garanti, plus haut que celui du marché international et qui ne change pas tous les mois. C'est une bonne idée de travailler avec de petits agriculteurs réunis en coopératives... Mais que se passe-t-il pour les personnes qui travaillent pour ces petits agriculteurs : journaliers, ouvriers ? Selon Politis, ceux-là ne sont pas mieux payés.
Autre problème : au début, le commerce équitable a été porté, promu, par des associations, des gens de bonnes volontés... Maintenant, les produits équitables sont vendus surtout dans les grands magasins où les employés sont souvent mal payés et ont des horaires de travail pénibles : un peu le matin, un peu l'après-midi... Ce ne serait pas mal d'imaginer des règles de commerce équitable pour les personnes qui travaillent dans les grandes surfaces.
Améliorer les règles
Acheter des produits du commerce équitable reste une bonne idée parce que les producteurs des pays "pauvres" sont mieux rétribués. Mais il faut améliorer les règles du commerce équitable, pour que la nourriture équitable soit obligatoirement bio; et pour que les règles sociales soient améliorées. c'est ce qui ressort de la lecture de ce numéro spécial de Politis (qui comporte également une partie sur le tourisme) : le commerce équitable reste une bonne idée, mais ses règles doivent évoluer, au risque que l'idée finisse déconsidérée.
Christian Le Meut
Politis, hors série n°45, 2 impasse Delaunay, 75011 Paris. Tél. 01 55 25 86 86.
* Coulisses du commerce équitable, mensonges et vérités sur un petit commerce qui monte, édition Mille et une nuits, 2006.
17:20 Publié dans Buhez pemdeziek/Vie quotidienne, Endro/environnement, Etrebroadel/International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Bio, commerce équitable, Politis
07/11/2007
Politis : Konverzh reizh... ha bio ?
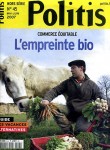 Un niverenn ispisial ag ar gazetenn sizhunieg Politis a zo bet embannet araok an hañv a zivout ar c'honverzh reizh hag ar bio. Abaoe un nebeut bleadeù ar c'honverzh reizh a ya war greskiñ. Kavet vez bremañ boued, gwiskamentoù ha produioù reizh a bep sort barzh ar stalioù bras, ar gourmarc'hadoù. Met petra a dalv an dra-se ? Peanos e vez savet produioù "ekitapl" ? Perak ez eus boued reizh ha n'eo ket bio ? Peseurt diforc'h a zo evit al labourerion douar ag ar broioù "paour" ? Ha perak nompass sevel amañ ivez, en Europa, ur c'honverzh reizh ?
Un niverenn ispisial ag ar gazetenn sizhunieg Politis a zo bet embannet araok an hañv a zivout ar c'honverzh reizh hag ar bio. Abaoe un nebeut bleadeù ar c'honverzh reizh a ya war greskiñ. Kavet vez bremañ boued, gwiskamentoù ha produioù reizh a bep sort barzh ar stalioù bras, ar gourmarc'hadoù. Met petra a dalv an dra-se ? Peanos e vez savet produioù "ekitapl" ? Perak ez eus boued reizh ha n'eo ket bio ? Peseurt diforc'h a zo evit al labourerion douar ag ar broioù "paour" ? Ha perak nompass sevel amañ ivez, en Europa, ur c'honverzh reizh ?
Setu temoù an niverenn ispisial-se, interesus-bras. Rak tabut 'zo, tabut da vat. Ar bio a zo un doare resis da c'hounit edajoù, legumajoù, frouezh, da zesav loened, d'o soagnal ivez, hep lakaat produioù kimiek. Lezennoù resis a zo evit ar bio. Ha roet 'vez al label-se get stalioù sertifiet get ar Stad hag a zo distaget d'ar broduierion ha d'ar c'honversanted (evel Ecocert), ar pezh n'eo ket gwir evit ar c'honverzh reizh a vez kontrolet get tud daet ag ar c'honverzh reizh !
Reizh ne dalv ket bio
Barzh boued ar c'honverzh reizh e c'heller kavout produioù kimiek, n'eo ket difennet d'o implijout, evel ar pezh a zispleg Christian Jacquiau* : barzh ananaz "reizh" gouniet er C'Hosta Rika a oa bet kavet e 2006 roudoù pestisidoù ha memes roudou kadmium (ur "metal lourd")...
Ur sonj vat eo paeañ al labourerion douar get ur priz ingal, uheloc'h evit priz ar marc'had etrebrodael, ha ne chañch ket penn da benn bep miz. Ur sonj vat eo labourat get labourerion douar "bihan" tolpet barzh kooperativoù... Met penaos eo an traoù evit an dud a labour evit ar labourerion douar-se : devezhourion, micherourion ? War e seblant, hervez Politis, ar re-se n'int ket paeet gwelloc'h.
Ur gudenn all : e penn kentañ ar c'honverzh reizh veze kaset, brudet, get kevredigezhioù, tud a youl vat... Bremañ ar broduioù a vez gwerzhet dreist holl barzh ar gourmarc'hadoù e lec'h ma vez paeet fall an dud, get euriadoù labour torr penns (un nebeut da vintiñ, un nebeut d'enderv...). Evit ar re a labour barzh ar gourmarc'hadoù amañ, ne vehe ket fall sevel reolennoù reizh ivez !
Gwellaat ar reolennoù
Daoust d'an traoù-se, prenañ produioù "ekitapl" n'eo ket fall peogwir e vez paeet gwelloc'h al labourerion douar ag ar broioù "paour". Met ret eo gwellaat reolennoù ar c'honverzh reizh, evit ma vehe dre ret, bio, ar broduioù "reizh"; hag evit ma vehe gwelloc'h reolennoù sokial ar c'honverzh reizh. Setu ar pezh m'eus sonjet goude bout lennet an niverenn ispisial Politis (pajennoù a zo ivez war an touristelezh reizh) : ret eo d'ar c'henverzh reizh chañch e reolennoù evit nompass bout brudet fall un deiz bennak.
Christian Le Meut
* Bet skrivet getan : Coulisses du commerce équitable, mensonges et vérités sur un petit commerce qui monte, embannadurioù Mille et une nuits, 2006.
Politis, hors série n°45, 2 impasse Delaunay, 75011 Paris - tél : 01 55 25 86 86 - www.politis.fr - redaction@politis.fr
11:20 Publié dans Buhez pemdeziek/Vie quotidienne, Endro/environnement, Etrebroadel/International, Mediaioù/média/skinwel/Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Bio, brezhoneg, konverzh reizh
06/11/2007
Australie/Aostralia : diaes e chom stad an Aborigened
 An Aborigened a oa e chom en Aostralia pell araok an Europeaned met ar vro-se, an douar-bras-se kentoc'h, a zo bet aloubet penn da benn hag an aborigened a zo bet lakaet barzh parkoù... En ugentved kantved ar vugale oa bet dispartiet ag o zud da vout roet da familhoù gwenn evit deskiñ saozneg... An traoù a chanch, neoazh : hiriv an deiz 10 % ag an douaroù a zo bet roet en dro d'an Aborigened da vout renet gete met an darempredoù get gouarnamant Kanberra a chom diaes. Bec'h a zo etre an Aborigened, a chom paour hag er maez ag ar gevredigezh, ha pennoù bras ar vro. Setu ar pezh a ziskouezh niverenn diwezhañ Courrier international (887 - 21/10/2007).
An Aborigened a oa e chom en Aostralia pell araok an Europeaned met ar vro-se, an douar-bras-se kentoc'h, a zo bet aloubet penn da benn hag an aborigened a zo bet lakaet barzh parkoù... En ugentved kantved ar vugale oa bet dispartiet ag o zud da vout roet da familhoù gwenn evit deskiñ saozneg... An traoù a chanch, neoazh : hiriv an deiz 10 % ag an douaroù a zo bet roet en dro d'an Aborigened da vout renet gete met an darempredoù get gouarnamant Kanberra a chom diaes. Bec'h a zo etre an Aborigened, a chom paour hag er maez ag ar gevredigezh, ha pennoù bras ar vro. Setu ar pezh a ziskouezh niverenn diwezhañ Courrier international (887 - 21/10/2007).
Les Aborigènes habitaient l'Australie bien avant les Européens mais ce pays, ce continent plutôt, a été envahi complètement et les Aborigènes ont été parqués... Aux XXe siècle, les enfants ont été séparés de leurs parents pour être confiés à des familles blanches et apprendre l'anglais... Les choses changent cependant : actuellement, 10 % des terres ont été rendues aux Aborigènes pour être gérées par eux, mais les relations continuent d'être difficiles avec le gouvernement de Canberra. Il y a de la tension entre les Aborigènes, qui demeurent pauvres et marginalisés, et les dirigeants du pays. C'est ce que montre le dernier numéro de Courrier International (887-21/10/2007).
Petites citations :
"A la fin du XVIIe siècle, il existait en Australie 250 langues aborigènes distinctes et environ 400 dialectes. Selon le docteur Amery, de l'Université d'Adelaide, il ne reste aujourd'hui que 17 langues, "dont la moitié ne surviront probablement pas à la prochaine décennie". (...) le linguiste explique que les budgets alloués à la préservation de ces langues ont été détournés au profit d'autres actions dans le Territoire du Nord".
- "La culture des Aborigènes semblait simple, parce qu'ils ne possédaient pas grand-chose de concret. Mais en termes de richesses intangibles - langues, spiritualités et relations humaines - elle est d'un étonnant degré de complexité. Une complexité qui continue d'entraver les relations avec les dirigeants de facto de l'Australie" (Germaine Greer).
09:55 Publié dans Etrebroadel/International, Gwirioù mab den/droits de l'être humain, Politikerezh/Politique, Yezhoù/langues | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Australie/Aostralia, Aborigènes




